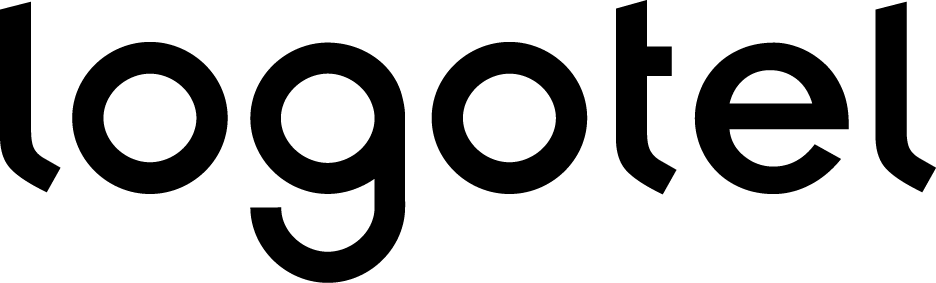L’intelligence artificielle générative connaît actuellement un engouement considérable, alimenté par des applications spectaculaires et des résultats souvent surprenants. Mais si, au cours des premiers mois, le débat s’est concentré sur les invites, la créativité automatique et les chatbots conversationnels, aujourd’hui, de nombreuses organisations se posent une question plus concrète : comment générer une valeur réelle et mesurable avec la GenAI ?
Dans les écoles d’écriture créative, on utilise souvent l’expression « Show, don’t tell », que l’on pourrait traduire en français par « Ne racontez pas, montrez ». Ce conseil souligne la plus grande efficacité d’une approche visant à montrer les choses plutôt qu’à les raconter ou les décrire.
C’est un peu ce que font Rob Thomas, Paul Zikopoulos et Kate Soule dans leur livre AI Value Creators publié par O’Reilly. Dans le quatrième chapitre de leur ouvrage, ils soulignent qu’il ne suffit pas de « tester » l’intelligence artificielle. Il faut concevoir son intégration avec méthode, vision stratégique et attention au contexte, à partir d’une cartographie claire des cas d’utilisation.
C’est précisément là le point essentiel : la GenAI n’est pas une technologie « universelle ». Sa valeur dépend fortement du secteur d’activité, des données disponibles, des processus existants et de la maturité numérique de l’organisation.
Dans cet article, en nous basant sur le contenu du livre mentionné, nous explorons comment construire des cas d’utilisation efficaces, quels sont les archétypes les plus courants et comment la GenAI peut passer d’une expérience à un atout stratégique pour différents secteurs.
Des projets expérimentaux aux systèmes évolutifs : un changement de mentalité
L’une des erreurs les plus courantes dans l’adoption de la GenAI est de penser qu’un simple « test » suffit pour évaluer son potentiel. Mais dans un modèle d’intégration de l’IA où l’intelligence artificielle est simplement ajoutée aux processus existants, sans les repenser, la valeur reste souvent limitée, fragmentaire et peu durable.
Le véritable bond en avant se produit avec le passage à ce que les auteurs du livre appellent le modèle AI+. Dans cette vision, il ne s’agit pas d’intégrer l’IA comme un outil auxiliaire, mais de repenser les processus, les produits et les relations en plaçant l’intelligence artificielle au centre. Cette approche nécessite de partir des cas d’utilisation, et non de la technologie. Il faut se demander : quel est le problème que nous voulons résoudre ? Quel processus peut être réinventé ? Quel impact pouvons-nous générer pour nos clients, nos employés ou nos partenaires ?
Il en résulte un nouveau type de conception, plus proche de celle des produits numériques que d’un projet informatique classique. Il faut une approche multidisciplinaire, une appropriation diffuse, des mesures claires et une itération continue.
Archétypes de valeur : les cas d’utilisation les plus courants et transversaux
Lorsqu’ils élaborent des cas d’utilisation, les auteurs proposent une classification par archétypes : des modèles récurrents qui, bien qu’adaptables à tous les secteurs, permettent de mieux orienter les investissements. Parmi les plus pertinents, on trouve :
- Automatisation des connaissances
La GenAI est extrêmement efficace pour absorber, synthétiser et restituer des informations. Dans les secteurs où la densité documentaire est importante, tels que le secteur juridique, les assurances, la santé ou l’administration publique, elle devient un outil permettant de réduire considérablement le temps consacré à la recherche, à la rédaction et à la révision. La génération de rapports, de résumés, de contrats ou de réponses complexes à l’aide de invites bien conçues permet de libérer plusieurs heures de travail chaque semaine. - Assistance opérationnelle et agents autonomes
Dans le commerce de détail, la logistique ou le service client, la GenAI peut être utilisée pour créer des agents virtuels qui interagissent avec les systèmes de l’entreprise (CRM, ERP, base de connaissances), prennent des décisions guidées par des politiques et apprennent au fil du temps. Il ne s’agit plus de simples chatbots, mais d’agents multi-étapes capables d’orchestrer des activités réelles. - Personnalisation évolutive
Dans le marketing, la formation, la communication interne – comme par exemple dans les intranets ou les communautés numériques d’entreprise conçues par la société de design Logotel pour ses clients – la possibilité de générer des contenus personnalisés par personne ou par segment représente une révolution. Finis les messages standardisés, place aux contenus dynamiques, construits sur la base des comportements, des préférences et des objectifs individuels. - Soutien à la créativité technique
Dans des domaines tels que l’ingénierie, la R&D ou la conception de logiciels, la GenAI aide à explorer des alternatives, à générer de la documentation et à tester des hypothèses. Elle ne remplace pas l’expertise, mais multiplie la capacité d’explorer et de valider des scénarios, accélérant ainsi l’innovation.
Focus sur l’industrie : comment la valeur de la GenAI varie en fonction du contexte
La valeur de la GenAI varie considérablement selon le secteur dans lequel elle est appliquée. Voici quelques exemples concrets.
Dans le secteur pharmaceutique, l’IA générative peut être utilisée pour accélérer la découverte de médicaments, en générant des molécules candidates à partir d’objectifs thérapeutiques spécifiques. Mais elle peut également servir aux affaires médicales pour rédiger et traduire rapidement la documentation réglementaire, ou pour simplifier la formation technique interne sur des produits complexes.
Dans le secteur manufacturier, la GenAI joue un rôle dans la documentation technique, la maintenance prédictive assistée par des modèles linguistiques, la formation des ouvriers grâce à des systèmes conversationnels intégrés dans des environnements industriels. L’avantage réside souvent dans l’intégration avec des données visuelles, sensorielles ou historiques.
Dans le monde financier, la génération automatique de rapports d’analyse, la gestion documentaire réglementaire et la création d’outils d’aide au conseil permettent déjà de réduire les coûts et d’améliorer la conformité. Ici, le défi consiste à combiner l’IA générative avec des systèmes de contrôle rigoureux et l’explicabilité.
Dans l’administration publique, la GenAI peut améliorer l’accès aux services pour les citoyens, automatiser les communications standard, simplifier les appels d’offres et les formulaires. Mais elle nécessite une attention particulière aux biais, à la transparence et à la langue naturelle locale.
Mesurer la valeur et la faisabilité : la courbe d’impact
Un outil utile pour orienter la sélection des cas d’utilisation est la courbe de création de valeur des cas d’utilisation, qui met en relation l’impact potentiel et la faisabilité. En bas à gauche, nous trouvons les cas d’utilisation à faible impact mais très simples à mettre en œuvre, parfaits pour démarrer et créer une dynamique. En haut à droite, ceux qui sont stratégiques, plus complexes mais hautement transformateurs.
L’objectif n’est pas de tout faire immédiatement, mais d’élaborer une feuille de route qui équilibre les gains rapides et les projets structurels. Les meilleurs parcours d’adoption partent d’un cas d’utilisation bien sélectionné, mesurable, avec un sponsor clair, et évoluent grâce à la réutilisation de prompts, de jeux de données et de modèles dans d’autres domaines.
Comment structurer un cas d’utilisation efficace
Pour fonctionner correctement, chaque cas d’utilisation de l’IA doit reposer sur une structure claire. Les éléments fondamentaux sont les suivants :
- Un objectif commercial explicite, non technique. Il doit répondre à la question « quelle valeur apportons-nous, à qui ? ».
- Un ensemble de données disponible ou constructible, d’une qualité suffisante pour alimenter la GenAI. La collecte et le traitement des données sont souvent plus importants que le modèle utilisé.
- Un flux de travail intégrable : le modèle ne peut pas rester « en dehors » du système. Il doit s’intégrer à ce que les gens utilisent déjà.
- Une évaluation de l’impact : gain de temps, amélioration de la précision, qualité perçue, retour sur investissement. Sans mesure, il n’y a pas de valeur mesurable.
- Une équipe hybride : chef d’entreprise, data scientist, expert du domaine, designer. La GenAI n’est pas une technologie à laisser « aux techniciens ».
Du pilote à la production : le point sensible
L’un des obstacles les plus courants est le passage du projet pilote à la mise en production. De nombreuses équipes élaborent des preuves de concept (POC) intéressantes qui ne sont toutefois jamais intégrées dans les processus réels. Les raisons ? Manque de sponsors, absence de gouvernance claire, systèmes hérités difficiles à connecter ou manque d’équipes capables de « prendre en charge » le modèle une fois qu’il est opérationnel.
Pour éviter cela, il faut penser à la scalabilité dès la phase de conception. Impliquer ceux qui devront utiliser le système. Concevoir l’intégration. Prévoir la formation continue. Et surtout, reconnaître qu’un système d’IA est un produit vivant, et non un projet « fini ».
La valeur ne réside pas dans le modèle, mais dans le contexte
Créer de la valeur avec GenAI ne signifie pas utiliser le modèle le plus puissant, mais le plus adapté. Celui qui répond le mieux à un problème réel, avec des données accessibles, et qui peut être mis en production avec les outils déjà présents dans l’entreprise. La véritable valeur naît de l’intégration : entre les technologies, entre les personnes, entre la vision et l’opérationnalité.
L’avenir ne sera pas dominé par ceux qui possèdent le plus de GPU, mais par ceux qui sauront concevoir des cas d’utilisation évolutifs, mesurables, éthiques et utiles. Et cela commence par une simple question : quel problème voulons-nous vraiment résoudre, et pour qui ?