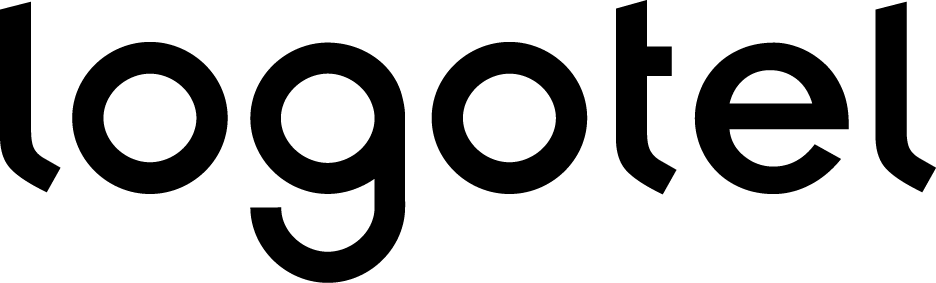Une étude révèle le paradoxe de l’IA en entreprise : alors que les employés augmentent leur productivité de 40 % grâce à des outils personnels, les initiatives officielles échouent dans 95 % des cas. Les projets efficaces sont centrés sur les personnes et les communautés, et non sur la technologie.
95 % des projets d’IA générative en entreprise n’apportent aucun retour sur investissement (ROI) mesurable. C’est le chiffre clé d’un rapport publié en juillet, qui a « gâché » l’été de nombreux entrepreneurs, managers, prestataires de services d’IA et sociétés spécialisées dans l’adoption de ces technologies.
Certains y voient un paradoxe, d’autres annoncent un « hiver de l’IA », renforcé par les déclarations du PDG d’OpenAI, Sam Altman, sur le risque d’échec pour de nombreuses start-up du secteur.
Pourtant, le rapport The GenAI Divide : State of AI in Business 2025, produit par NANDA (Networked Agents and Decentralized Architecture), une initiative du MIT Media Lab, peut aussi être interprété comme une opportunité.
En se concentrant sur les 5 % de projets qui réussissent, les dirigeants peuvent comprendre les erreurs à éviter et se positionner du bon côté de la fracture de l’IA générative évoquée par l’étude.
Ce n’est donc pas le moment de tout abandonner, mais de comprendre ce qui distingue les projets efficaces de ceux qui échouent, et d’identifier les causes de ces échecs. C’est l’objectif de cet article.
Comment l’étude MIT/Nanda a été menée : échantillon et limites
Avant d’interpréter les résultats de l’étude The GenAI Divide : State of AI in Business 2025, il faut comprendre sa méthodologie et ses limites. L’étude, réalisée entre janvier et juin 2025, a analysé plus de 300 initiatives publiques de mise en œuvre de l’IA. Elle s’appuie sur 52 entretiens structurés avec des représentants d’entreprises et 153 sondages recueillis auprès de cadres supérieurs lors de quatre grandes conférences du secteur.
Pour qualifier un projet d’IA comme « réussi », les auteurs ont retenu les initiatives ayant dépassé la phase pilote, avec des KPI mesurables. L’impact en termes de ROI a été évalué six mois après cette phase.
Les auteurs signalent plusieurs limites :
- L’échantillon ne couvre pas tous les secteurs ni toutes les régions.
- Un biais de sélection est possible, car les organisations prêtes à partager leurs défis diffèrent de celles qui ont refusé.
- Les chiffres concernant les outils spécifiques reposent sur des entretiens individuels, et non sur des rapports officiels.
- Les définitions du succès varient selon les secteurs.
- Les mesures de ROI peuvent être influencées par des facteurs externes ou des améliorations concomitantes.
Enfin, la période d’observation de six mois est courte pour juger du succès à long terme.
Principales conclusions de l’étude MIT/Nanda : des chiffres qui donnent à réfléchir
Malgré 30 à 40 milliards de dollars investis par les entreprises dans l’IA générative, seuls 5 % des projets atteignent la production avec une valeur mesurable pour le compte de résultat.
Un fossé existe entre l’adoption individuelle des outils d’IA et leur déploiement organisationnel. Des outils comme ChatGPT ou Copilot (LLM généralistes) sont largement utilisés : plus de 80 % des organisations les ont testés, et près de 40 % les ont adoptés durablement. Mais ces outils améliorent surtout la productivité individuelle.
À l’inverse, les systèmes d’entreprise personnalisés ou proposés par des fournisseurs spécialisés, censés améliorer la performance globale, affichent des taux de conversion très faibles :
- 60 % des organisations les ont évalués,
- 20 % ont atteint la phase pilote,
- et seulement 5 % sont passés en production.
Les causes ? Fragilité des workflows, absence d’apprentissage contextuel et manque d’intégration dans les opérations quotidiennes.
Pourquoi les projets échouent : 4 facteurs clés
- Perturbation limitée : seuls les secteurs Media et Tech montrent des changements structurels significatifs.
- Paradoxe commercial : les grandes entreprises multiplient les pilotes mais peinent à les déployer à grande échelle.
- Biais d’investissement : priorité aux fonctions visibles (marketing, ventes) au détriment des back-offices où les gains seraient plus élevés.
- Avantage des partenariats : les projets internes ont 33 % de chances de succès contre 67 % pour les partenariats externes, qui apportent expertise et expérience.
Mais le principal obstacle reste le fossé d’apprentissage : la plupart des systèmes d’IA générative n’ont pas de mémoire, n’apprennent pas des retours, ne s’adaptent pas au contexte et ne s’améliorent pas avec le temps.
L’économie souterraine de l’IA : un paradoxe révélateur
90 % des employés utilisent régulièrement des outils d’IA personnels (comme ChatGPT), mais seules 40 % des entreprises ont acheté des licences officielles.
Résultat :
- Productivité individuelle : +40 à +70 %,
- mais aucune valeur organisationnelle mesurable, en raison de :
- la fragmentation des efforts : chaque collaborateur optimise son travail de manière isolée, sans coordination ni partage des gains.
- l’absence de standardisation : les bonnes pratiques restent individuelles et ne sont pas intégrées dans les processus de l’entreprise.
- les risques de conformité et de sécurité : les données sensibles peuvent être exposées sur des plateformes non contrôlées, créant des vulnérabilités.
- la perte de mémoire organisationnelle : les connaissances générées par l’IA ne sont pas capturées dans les systèmes internes, ce qui empêche leur réutilisation.
Ce phénomène montre que les employés recherchent des outils flexibles et immédiats, mais sans une approche structurée, les gains individuels ne se transforment pas en valeur collective.
Ce qui fonctionne : les clés des projets réussis
Systèmes qui apprennent et maintiennent la mémoire et le contexte
66 % des dirigeants interrogés demandent des IA capables de se souvenir des interactions, maintenir le contexte, s’adapter aux retours et s’améliorer avec le temps. Une IA qui se contente de répondre ne suffit plus : il faut des systèmes évolutifs qui intègrent la mémoire et l’apprentissage continu pour rester pertinents dans les workflows.
Partenariats stratégiques
Les projets les plus efficaces privilégient les partenariats externes plutôt que le développement interne. Pourquoi ? Parce que les partenaires apportent une expérience éprouvée, des connaissances intersectorielles et la capacité de gérer les défis culturels liés à l’adoption. Ce pragmatisme réduit les risques et accélère la mise en œuvre.
Personnalisation des workflows
Les solutions génériques échouent souvent. Les projets réussis partent de processus spécifiques, parfois périphériques mais critiques, et s’intègrent profondément dans les opérations existantes. Une configuration agile et un ROI rapide sont des facteurs clés pour éviter les déploiements lourds et inefficaces.
Approche ascendante avec responsabilité centrale
Les déploiements efficaces impliquent les « prosommateurs », ces employés qui utilisent déjà l’IA à titre personnel et comprennent intuitivement ses capacités et ses limites. Les organisations performantes décentralisent l’autorité pour favoriser l’expérimentation, tout en maintenant une responsabilité centrale pour garantir la cohérence et la sécurité. Cette logique « bottom-up » crée un engagement fort et accélère l’adoption.
Focus sur les résultats business, pas sur la technologie
Les projets qui réussissent évaluent l’IA sur des indicateurs business concrets :
- Réduction des coûts d’externalisation (centres d’appels, traitement documentaire),
- Accélération de la qualification des prospects,
- Diminution des dépenses auprès des agences externes (consultants, création de contenu).
Les dirigeants ne se laissent pas séduire par des démonstrations spectaculaires mais vides : ils exigent des preuves tangibles de l’impact sur la performance.
Capitaliser sur l’économie souterraine de l’IA
Plutôt que de combattre l’usage non officiel des outils IA, les organisations avant-gardistes l’analysent pour identifier :
- les tâches réellement optimisées par l’IA,
- les workflows qui bénéficient le plus de son aide,
- les pratiques individuelles à transformer en processus organisationnels,
- les meilleures pratiques à capturer et diffuser.
Cette approche permet de convertir des gains isolés en valeur collective.
Pour les tâches complexes, les humains surpassent l’IA
L’un des enseignements les plus intéressants du rapport concerne la centralité de l’élément humain.
C’est avant tout une question de confiance, liée notamment à la faible « mémoire » de nombreux outils d’IA évoquée précédemment. Les participants à l’étude MIT/NANDA ont été interrogés : confieraient-ils un projet simple et un projet complexe à un collègue humain ou à une IA générative ?
La hiérarchie des préférences est nette :
- Pour les tâches rapides (emails, résumés, analyses basiques), l’IA est privilégiée dans 70 % des cas.
- Mais pour les problèmes complexes ou à long terme, les humains dominent par un ratio de 9 contre 1.
La ligne de démarcation n’est pas l’intelligence brute, mais la mémoire, l’adaptabilité et la capacité d’apprentissage – des caractéristiques qui séparent les deux côtés de la fracture IA.
En conclusion : il est temps de changer d’approche
Le message du rapport du MIT est sans équivoque : 95 % des projets d’IA échouent non pas à cause de limitations technologiques, mais à cause de mauvaises approches. Pour les chefs d’entreprise qui souhaitent se positionner dans le 5 % gagnanLe message du rapport MIT est clair : 95 % des projets d’IA échouent non pas à cause de la technologie, mais à cause de mauvaises approches. Pour rejoindre le cercle des 5 % qui réussissent, voici les actions concrètes à mettre en œuvre :
1. Commencez par les personnes, pas par la technologie
Identifiez les « prosommateurs » déjà actifs dans votre organisation – ces employés qui utilisent ChatGPT ou d’autres outils IA au quotidien. Ils sont vos meilleurs alliés pour comprendre ce qui fonctionne réellement et pour initier une adoption efficace.
2. Créez des communautés d’expérimentation
L’IA qui génère de la valeur vient d’en bas, pas d’en haut. Mettez en place des espaces sécurisés où les équipes peuvent tester, échouer et partager leurs apprentissages. Une approche communautaire, comme celle expérimentée avec succès dans le projet Dojo de Logotel pour Italgas, transforme l’innovation en dynamique systémique.
3. Mesurez ce qui compte
Abandonnez les indicateurs de vanité. Le véritable ROI se mesure par des résultats tangibles :
- réduction des coûts d’externalisation,
- accélération des processus,
- amélioration de la qualité du service client.
Si vous ne pouvez pas relier l’IA à une amélioration concrète du compte de résultat, votre projet est mal orienté.
4. Choisissez des partenaires, pas des fournisseurs
Les mises en œuvre réussies reposent sur des partenariats stratégiques, et non sur des développements internes isolés. Recherchez des partenaires capables de comprendre vos processus et de concevoir des solutions personnalisées qui apprennent et évoluent.
5. Agissez maintenant, mais méthodiquement
Le rapport MIT/NANDA indique que la « fenêtre » pour se positionner du bon côté de la fracture IA se referme rapidement. Les entreprises qui investissent dès aujourd’hui dans des systèmes capables d’apprendre des données et des retours créent des avantages concurrentiels difficiles à rattraper.
Les 5 % de projets IA réussis ne sont pas une élite inaccessible : ce sont des organisations qui ont compris une vérité simple. L’IA générative n’est pas une baguette magique, mais un outil qui amplifie la capacité humaine à créer de la valeur.
La question n’est pas « faut-il adopter l’IA ? », mais comment l’adopter pour générer des résultats mesurables. Et la réponse, comme le montre le rapport, réside dans le fait de placer les personnes et les communautés au cœur du processus de transformation.