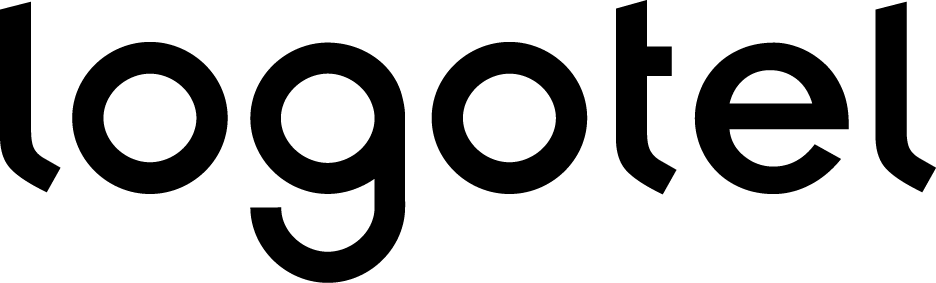L’intelligence artificielle peut parfois être perçue comme quelque chose d’extérieur à l’organisation : un outil à consulter, un moteur à activer, un support pour simplifier les tâches répétitives. Mais l’évolution rapide des modèles de langage génératif – tels que GPT-4 – nous confronte aujourd’hui à un changement radical de paradigme. Il ne s’agit plus d’« utiliser » l’IA. Il s’agit d’y travailler ensemble.
L’étape clé est précisément celle-ci : de l’intelligence artificielle en tant que logiciel, à GenAI en tant que coéquipier. Un collègue digital avec qui dialoguer, collaborer, construire. Un coéquipier non humain, mais extraordinairement utile, capable d’augmenter non seulement la productivité individuelle, mais aussi la qualité du travail d’équipe, de l’apprentissage et de la prise de décision.
Dans ce scénario, il devient essentiel de repenser nos façons de travailler, les processus de gestion de la performance, les rôles dans les équipes et, surtout, la façon dont les gens interagissent avec les technologies émergentes. Il n’est pas seulement nécessaire d’adopter des outils. Nous devons adopter une nouvelle mentalité.
L’IA comme un collègue, pas comme un outil
Les technologies génératives ne sont pas comme les outils du passé. Il ne s’agit pas de tableurs, ni de logiciels verticaux. Ce sont des systèmes conversationnels, capables de comprendre le langage naturel, d’analyser de grands volumes de données, de générer du texte, des images, du code, des plans de projet ou des idées créatives. Mais ce qui les rend vraiment différents, c’est la façon dont nous pouvons interagir avec eux.
Ethan Mollick, professeur agrégé à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, écrit dans son blog Une chose utile que GenAI peut et doit être traité comme un coéquipier cybernétique. Il ne s’agit pas d’un simple « assistant virtuel », mais d’une entité avec laquelle dialoguer, à qui expliquer des problèmes, être challengée, avec laquelle co-construire des solutions.
Lorsque nous adoptons cette perspective, tout change. On ne parle plus d’« invites » mais de conversations. Nous ne recherchons pas des réponses prédéfinies, mais la co-création. L’IA s’intègre dans nos flux de travail quotidiens non pas comme un service auxiliaire, mais comme une présence active, intégrée et collaborative.
L’impact sur la performance individuelle
L’un des domaines où l’adoption de GenAI montre déjà ses effets les plus forts est la productivité personnelle. Rédiger, synthétiser, traduire, reformuler, planifier, visualiser : chaque professionnel peut désormais confier une part importante du travail cognitif à GenAI, ce qui permet de gagner du temps et d’augmenter la qualité.
Mais l’impact ne s’arrête pas à la vitesse. Lorsque l’IA est utilisée de manière itérative – comme un partenaire avec lequel raisonner, examiner, explorer des alternatives – elle stimule une réflexion plus profonde et plus articulée. Il ne se contente pas de produire des résultats. Cela aide les gens à mieux penser.
De plus, en réduisant le fardeau des tâches à faible valeur ajoutée, GenAI libère du temps mental pour des activités plus stratégiques : l’exploration, la réflexion, la collaboration et la créativité. Et même dans ce dernier domaine, traditionnellement considéré comme l’apanage de l’être humain, la combinaison de l’homme et de l’IA peut libérer un potentiel infini.
Pour que cela fonctionne, les entreprises doivent toutefois abandonner l’idée selon laquelle « plus de production équivaut à plus de performance » et commencer à mesurer la valeur de l’interaction avec l’IA non seulement en termes quantitatifs, mais aussi qualitativement : dans quelle mesure cela améliore-t-il la compréhension d’un problème ? Dans quelle mesure cela accélère-t-il l’apprentissage ? De combien la confiance augmente-t-elle avec une décision ?
Vers des équipes hybrides : humain + IA
Si le travail individuel a déjà changé, le travail d’équipe est à l’aube d’une transformation radicale. GenAI devient un membre supplémentaire des équipes, capable d’exercer des fonctions transversales : de la suggestion d’idées pour le développement de nouveaux produits et/ou services à la rédaction de comptes rendus, de l’aide à la rédaction de codes ou de présentations, à la facilitation de décisions complexes.
Dans une équipe de projet, par exemple, l’IA peut soutenir le leader dans la création de feuilles de route, aider les concepteurs à générer des concepts, soutenir le marketing dans la rédaction de contenu et suggérer des réponses basées sur la documentation interne. C’est comme avoir un collègue « multi-compétences » toujours disponible, capable de travailler sur n’importe quel type de tâche cognitive.
L’impact de l’IA dans le travail d’équipe
Mais quel est l’impact concret du travail d’équipe entre l’IA et l’humain ? C’est ce qu’a révélé une expérience de terrain menée au sein de la multinationale Procter & Gamble, dont les résultats ont abouti à un document de travail signé par Mollick et d’autres chercheurs de la Wharton School, de la Harvard Business School et de la multinationale elle-même.
Plus de 700 professionnels de Procter & Gamble avec plus de 10 ans d’expérience dans le commerce et la R&D ont été invités à se diviser en groupes et à développer des idées de nouveaux produits dans différents domaines de P&G, qui ont ensuite été soumises à la direction de l’entreprise.
Un premier groupe était composé de professionnels individuels, aidés par des outils d’IA générative. Deux autres groupes, composés d’un spécialiste par domaine, ont été divisés en deux entre des équipes exclusivement humaines, et d’autres qui avaient accès à des outils d’IA générative tels que GPT-4 ou GPT-4o.
L’étude a montré qu’en termes de performance, les équipes mixtes humain-IA avaient les meilleurs résultats, avec la plus forte probabilité de produire des solutions de qualité et un gain de temps de 12 à 16 %.
De plus, dans les équipes ayant accès à l’IA, les clivages cloisonnés entre les différentes spécialisations se sont estompés : les solutions proposées par ces équipes se sont avérées être les plus équilibrées entre les perspectives techniques et les solutions plus commerciales et commerciales.
La dernière preuve est l’impact émotionnel positif enregistré dans les équipes qui ont utilisé l’IA, avec une augmentation significative des émotions positives et une réduction des émotions négatives, telles que l’anxiété et la frustration.
Redéfinir les rôles et les attentes pour faire travailler l’équipe
Cependant, pour que le travail d’équipe entre l’IA et les humains fonctionne vraiment, les rôles et les attentes doivent être redéfinis. Qui décide de ce qu’il veut déléguer à GenAI ? Comment vérifiez-vous la qualité de votre contribution ? Qui est responsable du résultat final ? Comment intégrez-vous l’interaction avec l’IA dans les rituels d’équipe (réunions, sprints, revues) ?
Ces questions ne sont pas techniques. Ils sont organisationnels et culturels. Et ils nécessitent de repenser en profondeur la façon dont nous concevons la collaboration dans les équipes du futur.
L’incitation comme nouvelle compétence non technique
Interagir avec un modèle génératif n’est pas un acte mécanique. C’est une compétence communicative, presque relationnelle. Rédiger des invites efficaces, c’est savoir contextualiser un problème, clarifier les objectifs, offrir des commentaires et des commentaires, décomposer un défi en étapes logiques.
En d’autres termes, le Prompting devient une soft skill transversale et fondamentale. Et comme toutes les compétences générales, vous ne vous contentez pas de l’enseigner avec un tutoriel. Il doit être entraîné au fil du temps, par essais, erreurs et conscience. Les professionnels qui apprennent à « travailler avec l’IA » comme avec un collègue empathique et rationnel auront un énorme avantage concurrentiel.
Les entreprises, pour leur part, doivent commencer à former leurs équipes sur la façon de collaborer avec GenAI, et pas seulement sur la façon de l’utiliser. Et ils doivent le faire de manière transversale, sans reléguer ces compétences à un service technique ou d’innovation.
Il devient essentiel, à cette fin, d’adopter des approches de formation et d’adoption de GenAI qui encouragent la pratique continue, la discussion et le soutien, la possibilité de pratiquer dans un environnement sûr.
À cet égard, une approche communautaire de l’adoption de l’IA s’avère très efficace, avec la création de communautés d’adoption qui peuvent accélérer la diffusion d’un état d’esprit génératif au sein des entreprises et des organisations, comme le démontre par exemple l’étude de cas Dojo, une communauté développée par la société de design Logotel pour Italgas.
La gestion de la performance à l’ère de la collaboration augmentée
Le travail hybride homme-IA nécessite également de nouvelles façons d’évaluer les performances. Si une partie du travail est effectuée en collaboration avec un système génératif, il est nécessaire de comprendre ce qu’il faut évaluer et comment reconnaître la valeur humaine dans un processus amélioré.
Par exemple, en copywriting, est-il encore judicieux d’évaluer la vitesse de production du texte ? Ou est-il plus utile d’observer la capacité à donner un retour d’information à GenAI, à sélectionner le résultat le plus approprié, à orchestrer un flux créatif multi-agents ?
Il en va de même pour la gestion de projet, l’analyse de données, la stratégie. Les indicateurs traditionnels risquent d’être biaisés ou trompeurs. Nous avons besoin d’une nouvelle grammaire de la performance, dans laquelle la valeur humaine ne réside pas tant dans la production manuelle, mais dans la capacité à guider l’intelligence artificielle vers des résultats significatifs, éthiques et durables.
Risques à éviter : solitude, superficialité, délégation aveugle
Ce modèle n’est pas sans risques. Traiter GenAI comme un collègue peut conduire à une délégation excessive, à une confiance excessive ou à une superficialité dans le contrôle du contenu. Ou – au contraire – elle peut générer de l’isolement, les professionnels interagissant davantage avec des modèles génératifs qu’avec d’autres êtres humains.
Pour éviter ces extrêmes, il est essentiel de maintenir une supervision humaine active, de définir les rôles et les responsabilités, de cultiver des environnements collaboratifs dans lesquels l’IA est l’un des nombreux acteurs. Et surtout, continuer à développer l’esprit critique, les compétences de validation et la conscience du contexte.
Le travail en tant que collaboration augmentée
Le travail du futur ne sera ni entièrement humain ni entièrement automatisé. Il sera collaboratif, augmenté, conversationnel. Et dans ce scénario, GenAI représente l’un des changements les plus profonds jamais observés dans les modèles organisationnels.
Ce n’est pas seulement une question d’efficacité. C’est une nouvelle forme d’intelligence collective, dans laquelle les hommes et les machines raisonnent ensemble, se confrontent, s’enrichissent mutuellement. Pour que cela se produise, cependant, une vision, des compétences et de nouveaux paradigmes de performance sont nécessaires.