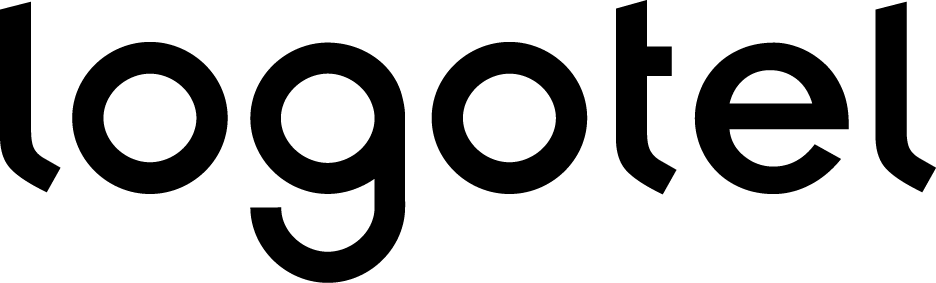L’IA générative devient un compagnon constant du travail quotidien. Un collègue cybernétique, selon Ethan Mollick, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.
Il nous aide à écrire, à synthétiser, à concevoir. Il répond à nos questions, structure nos idées, propose des alternatives. Parfois, il semble même savoir ce que nous voulons avant même que nous ne le demandions. Pourtant, malgré la puissance et la vitesse de GenAI, sa valeur dépend en grande partie de nous.
L’intelligence artificielle ne pense pas, ne comprend pas, ne ressent pas. Ce qu’il fait est élaboré. Et il le fait extraordinairement bien, mais seulement à partir de ce qu’on lui demande, du contexte qui lui est fourni, de la capacité de l’humain à guider, corriger, interpréter. Dans cette relation émergente entre l’humain et l’IA, les capacités humaines deviennent le véritable moteur de valeur.
Une perspective intéressante, en ce sens, provient d’une étude récente menée par Isabella Loaiza, chercheuse postdoctorale à la MIT Management Sloan School (l’école de commerce du Massachusetts Institute of Technology) et le professeur Roberto Rigobon.
Les deux hommes ont souligné les limites actuelles de l’IA et se sont demandé quelles capacités humaines pouvaient compléter ces lacunes. Leur approche s’écarte du « terrorisme psychologique » qui, dans certains cas, identifie l’IA comme une force qui remplacera les humains, et se concentre sur ce que les humains peuvent faire. Et, surtout, sur la façon dont l’humain et l’IA pourront se compléter. Dans cet article, nous approfondissons leurs recherches.
Les limites de l’IA
Dans l’histoire de l’humanité, les grandes innovations technologiques ont toujours suscité l’inquiétude et la méfiance, mais en général, elles ont amélioré la qualité du travail au lieu de l’aggraver.
L’intelligence artificielle, cependant, semble être différente : il s’agit d’une technologie tellement disruptive qu’elle peut difficilement être comparée aux innovations du passé et, comme l’écrivent Loaiza et Rigobon, « menace de remplacer des compétences profondément liées à nos capacités cognitives ».
De plus, « les vagues technologiques précédentes avaient tendance à avoir un impact négatif sur les travailleurs peu qualifiés, tandis que l’IA a un impact sur les travailleurs, quel que soit leur niveau d’éducation. »
Cependant, même l’IA, malgré les progrès rapides dans le domaine, a encore certaines limites. Parmi les exemples cités par l’étude Sloan du MIT, il y a l’incapacité à faire des inférences à partir de petits ensembles de données ou à extrapoler bien au-delà des ensembles de données sur lesquels elle est formée.
Et encore une fois, l’IA se retrouve en grande difficulté lorsqu’elle est confrontée à des problèmes qui ont plus de deux solutions possibles ou des décisions basées sur des expériences partagées.
Enfin, l’IA a du mal à prendre des décisions qui vont dans une direction différente de ce que les données suggèrent. Pensez à certaines décisions qui, remettant en question le statu quo, ont marqué des progrès en matière de droits civils, comme le droit de vote des femmes ou le mouvement des droits civiques.
Si l’IA avait existé, et que les humains s’étaient appuyés sur l’intelligence artificielle pour se prononcer, les « machines » auraient probablement suggéré de le faire différemment, comme le dit le chercheur Loaiza : « Les humains prennent parfois des décisions non pas parce que les données nous disent que c’est possible, mais parce que, par principe, cela devrait être fait ».
Le modèle Epoch : des capacités exclusivement humaines
Après avoir mis en évidence les limites actuelles de l’IA, Loaiza et Rigobon se concentrent sur ce qu’ils considèrent comme des compétences exclusivement humaines qui peuvent compenser les limites de l’intelligence artificielle. Les deux chercheurs ont inventé un acronyme, EPOCH, développant un cadre qui définit cinq catégories fondamentales. Analysons-les brièvement.
Empathie et intelligence émotionnelle
L’intelligence artificielle est aujourd’hui capable de détecter les émotions. Cependant, seuls les êtres humains peuvent créer une connexion significative et empathique, en partageant ce que les autres vivent.
Présence, réseautage et connexion
Ceux qui travaillent dans des professions telles que les infirmières, ceux qui aident les personnes âgées, ceux qui travaillent dans le journalisme savent à quel point la présence physique est importante pour créer des liens. Cette catégorie reste l’apanage de l’homme, qui, par sa présence, est capable de favoriser l’innovation et de collaborer avec ses collègues.
Opinion, jugement et éthique
La capacité de naviguer dans des situations éthiquement complexes tout en maintenant un jugement critique et une rigueur morale reste exclusivement humaine, du moins pour le moment (sauf bien sûr de tristes exceptions).
L’intelligence artificielle, quant à elle, a du mal à comprendre des concepts tels que la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes, qui sont très importants dans certains domaines tels que les professions juridiques ou l’industrie scientifique.
C’est un point important, également souligné par Ethan Mollick : l’IA n’a pas de morale. Il ne fait pas de distinction entre le droit et l’injuste, le licite et l’illégal, le sain et le toxique. Il peut être programmé pour adhérer à certains principes, mais il n’a pas de conscience ou de conséquences à gérer. C’est à ceux qui travaillent avec l’IA d’assumer la responsabilité ultime des décisions.
Créativité et imagination
Bien que le débat sur l’IA et la créativité soit vaste et évolutif, les auteurs de l’étude soutiennent que l’humour, l’improvisation et la capacité d’imaginer au-delà de la réalité restent des compétences humaines uniques, précieuses dans le design et le travail scientifique.
Espoir, vision et leadership
Enfin, il reste à relever des défis pour les humains malgré la faible probabilité de succès. Pensez à la décision de démarrer une nouvelle entreprise ou à des caractéristiques telles que le courage, la persévérance et l’esprit d’initiative.
L’IA ne remplacera pas le travail qui dépend de l’empathie, du jugement et de l’espoir
Après avoir terminé l’analyse des limites de l’IA et des capacités exclusivement humaines, les deux chercheurs du MIT Sloan ont utilisé leurs preuves pour se demander quels emplois sont les plus à risque de remplacement et lesquels le sont moins.
Sur la base d’une base de données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, O*NET, ils ont regroupé une série de tâches en attribuant à chaque groupe de tâches trois scores basés sur trois indicateurs clés :
- le risque de substitution, c’est-à-dire dans quelle mesure l’automatisation d’une tâche peut conduire une IA à remplacer un travailleur humain ;
- le potentiel d’augmentation, c’est-à-dire comment l’automatisation peut conduire à une augmentation de la productivité pour une tâche donnée
- ; le score lié aux catégories EPOCH, qui indique dans quelle mesure une tâche dépend des capacités humaines mentionnées ci-dessus et peut donc être protégée contre l’automatisation.
Après avoir comparé ces résultats à un changement global de l’emploi dans la main-d’œuvre américaine de 2016 à 2024, les chercheurs ont conclu que le travail qui dépend davantage de caractéristiques humaines telles que l’empathie, le jugement et l’espoir est moins susceptible d’être remplacé par l’intelligence artificielle.
À l’inverse, les tâches présentant un risque élevé d’automatisation comportent un risque plus élevé de perte d’emploi.
Pour Loaiza, les résultats de l’étude renforcent l’argument selon lequel l’IA devrait compléter et augmenter les travailleurs plutôt que de les remplacer, et ils constituent également un message important pour les chefs d’entreprise : « Dans de nombreux domaines, les travailleurs ne peuvent pas être complètement remplacés. Si vous visez une innovation disruptive ou une entreprise véritablement transformatrice, les humains ont un rôle énorme à jouer.
La collaboration, pas le remplacement
L’étude du MIT Sloan s’inscrit dans la lignée de nombreux autres experts et universitaires en IA qui préconisent la collaboration homme-machine. L’un des plus influents est le professeur Mollick, qui a consacré un livre à ce sujet au titre emblématique : Co-Intelligence : Vivre et travailler avec l’IA.
Dans son article de blog dans lequel il parle de l’IA en tant que coéquipier, Mollick ajoute que les personnes qui travaillent avec elle doivent apprendre à jouer un nouveau rôle : celui non pas de producteurs de contenu, mais celui d’orchestrateurs, de sélectionneurs, de validateurs.
Ceux qui travaillent avec l’IA ne se limitent pas à utiliser des commandes, mais doivent développer la conscience, le jugement, l’intuition. En d’autres termes, elle doit apporter, comme le soulignent également les recherches du MIT Sloan, des capacités humaines que l’IA ne possède pas et ne pourra jamais simuler complètement.
Cette vision collaborative entre l’humain et l’IA est au cœur de la démarche de certaines entreprises innovantes dans le domaine du conseil. La société de design indépendante Logotel, par exemple, adopte également son approche de l’IA centrée sur les personnes et la communauté, en se concentrant sur l’amélioration de la vie professionnelle et du bien-être des personnes. Il ne s’agit pas seulement de mettre en œuvre des technologies, il s’agit de concevoir des expériences où l’IA amplifie les capacités humaines sans les remplacer, créant ainsi des environnements de travail plus inclusifs et génératifs.
Conclusions : valoriser ce qui fait de nous des êtres humains
L’étude du MIT Sloan nous offre une perspective intéressante pour l’avenir du travail : il ne s’agit pas de concurrencer l’IA, mais de renforcer et d’améliorer ces capacités humaines uniques que la technologie ne peut pas reproduire. L’empathie, la créativité, le jugement éthique, la capacité d’inspirer l’espoir et de diriger avec vision sont des compétences qui acquièrent une nouvelle valeur à l’ère de l’intelligence artificielle.
Le véritable défi pour les organisations n’est donc pas de mettre en œuvre l’IA pour remplacer les travailleurs, mais de créer des environnements dans lesquels la technologie et l’humanité se renforcent mutuellement. Cela nécessite un changement de paradigme : investir dans la formation de compétences spécifiquement humaines, repenser les rôles pour renforcer la contribution humaine irremplaçable, et construire des cultures d’entreprise qui placent la collaboration homme-machine au centre.
L’avenir du travail sera caractérisé par cette symbiose : l’IA amplifiera nos capacités cognitives et opérationnelles, tandis que nous, les humains, apportons un sens, une direction et une valeur humaine à ce que nous faisons. Dans ce scénario, les organisations qui peuvent le mieux orchestrer cette collaboration gagnent, en créant des espaces où la technologie libère le potentiel humain plutôt que de le limiter.