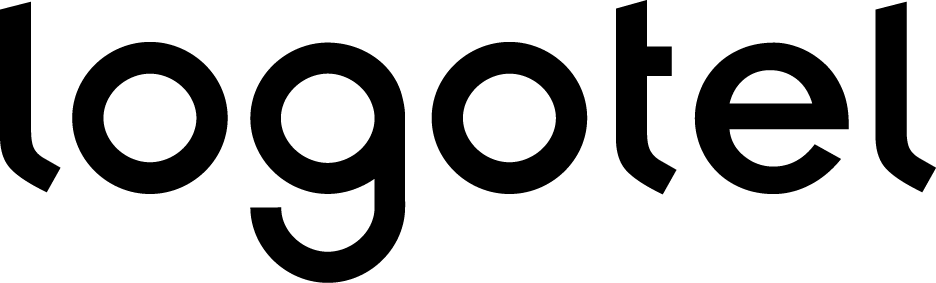Selon le MIT, ChatGPT peut créer une « dette cognitive », mais tout dépend de notre usage : raccourci facile ou levier pour amplifier nos capacités ?
ChatGPT nous rend-il moins intelligents ? L’IA générative est-elle nocive pour notre cerveau ? Ces questions alarmistes ont fleuri dans les médias après la publication d’une étude du MIT (Massachusetts Institute of Technology) sur l’impact de l’IA générative sur nos capacités cognitives.
Cette étude relance un débat ancien, qui accompagne chaque grande innovation : de l’écriture à Internet (Internet nous rend-il stupides ? de Nicholas Carr, publié en 2011), jusqu’à l’intelligence artificielle. La question reste la même : déléguer des tâches mentales à la technologie affaiblit-il notre cerveau ?
Le titre de l’étude du MIT, Your Brain on ChatGPT: Accumulating Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing, semble répondre par l’affirmative.
Pourtant, ses conclusions ne sont ni inattendues ni aussi alarmantes que certains titres le laissent croire. Dans cet article, nous résumons les résultats et proposons une lecture plus nuancée, en intégrant l’avis de l’expert en IA Ethan Mollick.
Qu’est-ce que le délestage cognitif ?
La technologie est conçue pour résoudre des problèmes et faciliter la vie. Mais externaliser certaines capacités entraîne une perte : c’est ce que les chercheurs appellent le délestage cognitif, c’est-à-dire déléguer des tâches à des systèmes externes pour réduire la charge mentale.
Dans certains cas, cette perte est limitée et acceptable. Par exemple, nous ne faisons plus de calculs complexes de tête grâce aux calculatrices. Dans d’autres, la prudence s’impose : suivre un GPS réduit notre sens de l’orientation. Peu de gens reviendraient aux cartes papier, mais il ne faut pas non plus suivre aveuglément les instructions, comme en témoignent les incidents rapportés par la presse.
Le délestage cognitif n’est donc pas forcément négatif : il libère du temps pour des tâches plus complexes. Il devient problématique lorsqu’il est automatique et passif, réduisant nos occasions d’exercer et de développer nos capacités.
Avec l’IA générative, ce phénomène prend une ampleur inédite : nous pouvons externaliser non seulement des tâches, mais aussi une partie de notre réflexion. D’où l’importance de réfléchir à comment et pourquoi nous utilisons ces outils.
Ce que révèle l’étude du MIT
L’étude menée par le MIT Media Lab a impliqué 54 participants répartis en trois groupes :
- un groupe utilisant ChatGPT,
- un groupe utilisant un moteur de recherche,
- un groupe sans outil externe.
Chaque participant a rédigé trois essais dans les conditions assignées, puis une quatrième session inversée (ceux avec ChatGPT ont écrit sans outil, et inversement).
Les chercheurs ont mesuré la charge cognitive via électroencéphalogramme (EEG), analysé les textes avec des techniques NLP et recueilli des évaluations humaines et IA.
Résultats clés :
- Les participants sans outils présentaient la connectivité cérébrale la plus forte.
- Ceux avec moteurs de recherche avaient un engagement modéré.
- Les utilisateurs de ChatGPT affichaient la connectivité la plus faible.
Lors de la quatrième session, ceux qui passaient de ChatGPT au travail sans outil montraient un sous-engagement cognitif, tandis que ceux qui découvraient ChatGPT voyaient une activation accrue des zones de mémoire.
Autre constat : le sentiment de « propriété » des essais était le plus faible chez les utilisateurs de ChatGPT, qui avaient aussi plus de mal à citer leur travail.
L’étude parle d’accumulation de dette cognitive : sur quatre mois, les utilisateurs de ChatGPT ont sous-performé sur le plan neuronal, linguistique et comportemental.
Pour Ethan Mollick, professeur à la Wharton School, le discours alarmiste « l’IA endommage le cerveau » est trompeur. L’étude montre simplement que les étudiants utilisant ChatGPT étaient moins engagés et retenaient moins leurs essais. Pas de « lésions cérébrales », mais un comportement prévisible : déléguer réduit l’implication.
La vraie question n’est pas si l’IA influence notre pensée, mais comment l’utiliser pour renforcer nos capacités plutôt que les affaiblir.
Utiliser l’IA comme tuteur, pas comme raccourci
Dans le contexte de l’apprentissage, utiliser l’IA sans stratégie adaptée peut être contre-productif. Pour apprendre efficacement, il faut fournir un effort cognitif ; or, recourir à l’IA comme raccourci peut nuire à la qualité de l’apprentissage.
Une étude menée par des collègues d’Ethan Mollick à l’Université de Pennsylvanie dans un lycée turc l’illustre bien : les étudiants qui utilisaient ChatGPT sans supervision ni consignes spécifiques prenaient des raccourcis et obtenaient des réponses directes. Résultat : bien qu’ils pensaient avoir beaucoup appris, leurs scores à l’examen final étaient inférieurs de 17 % à ceux des étudiants qui n’avaient pas utilisé ChatGPT.
Le problème est insidieux : même avec de bonnes intentions, l’IA tend à fournir des réponses plutôt qu’à guider vers la compréhension. Comme l’a montré l’étude du MIT, cela court-circuite l’effort mental nécessaire à l’apprentissage.
Cependant, l’IA ne nuit pas toujours à l’apprentissage. Des recherches récentes montrent qu’avec un encadrement pédagogique et des prompts conçus selon des principes éducatifs solides, elle peut améliorer considérablement les résultats.
Mollick cite un essai contrôlé randomisé de la Banque mondiale : l’utilisation d’un tuteur GPT-4, associé aux conseils d’enseignants dans un programme parascolaire de six semaines au Nigeria, a eu « plus du double de l’effet des interventions éducatives les plus efficaces », à très faible coût.
La clé, selon Mollick, est de passer de « demander à l’IA de faire le travail » à « demander à l’IA de nous aider à apprendre ». Cela implique des prompts spécialisés qui transforment l’IA d’un simple fournisseur de réponses en facilitateur d’apprentissage.
L’impact de l’IA sur la créativité et l’écriture
Dans son article Against Brain Damage, Mollick analyse aussi les effets de l’IA générative sur la créativité et l’écriture. Ses conclusions sont similaires : l’IA peut être utile, mais aussi délétère, selon la manière dont elle est utilisée.
En créativité, il identifie un paradoxe : l’IA peut générer des idées plus originales que celles de nombreux individus, mais elle manque de la diversité issue de multiples perspectives. Le risque ? L’effet d’ancrage : rester fixé sur les propositions de la machine et ne pas les ressentir comme les siennes.
Pour l’écriture, s’appuyer entièrement sur l’IA supprime les processus cognitifs essentiels – réflexion, structuration, affinage – liés à l’acte d’écrire.
La solution proposée par Mollick : générer ses propres idées et rédiger ses textes avant d’utiliser l’IA pour les améliorer.
Sa conclusion est claire : l’IA ne détruit pas notre cerveau, mais une utilisation passive peut nuire à notre pensée. Le vrai danger réside dans nos habitudes mentales et la paresse cognitive.
Réflexions finales
La question « l’IA nous rendra-t-elle plus stupides ? » est mal posée. Le vrai enjeu n’est pas de savoir si l’IA nuit à nos capacités, mais comment développer une relation consciente et productive avec ces outils.
Comme le souligne Cristina Favini, cofondatrice et directrice du design chez Logotel, il faut se rappeler que l’humain reste le sujet de l’initiative. L’IA doit être perçue comme une collègue qui amplifie le potentiel humain, et non comme un substitut.
L’étude du MIT ne dit pas que l’IA est mauvaise pour le cerveau : elle rappelle que penser exige un effort, et que cet effort est précieux. Utiliser l’IA comme raccourci pour éviter cet effort nous prive d’opportunités de croissance cognitive. Mais l’utiliser pour amplifier nos capacités, tout en gardant un contrôle critique, peut produire des résultats extraordinaires.
En définitive, ce n’est pas l’IA qui nous fait du mal : c’est notre choix de l’utiliser comme raccourci ou comme levier pour progresser.