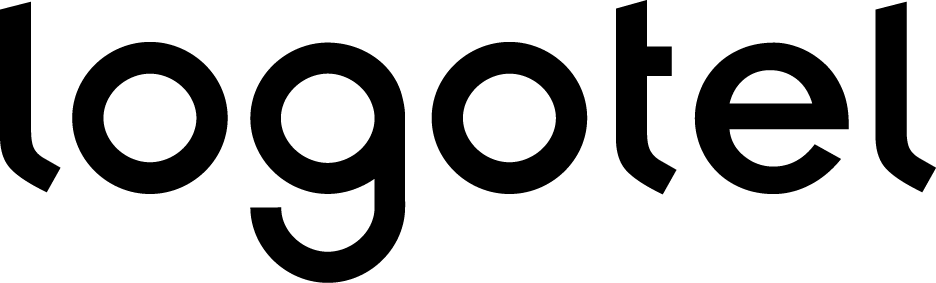Après la Grande Démission et la démission silencieuse, voici venu le temps du Grand Détachement : des personnes émotionnellement déconnectées de leur entreprise, mais qui n’ont ni les ressources ni les conditions nécessaires pour changer.
Il fut un temps où tout semblait pouvoir évoluer. La pandémie avait rebattu les cartes, révélant de nouvelles possibilités d’organisation du travail. Le travail intelligent promettait liberté, flexibilité et un nouvel équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Mais cinq ans plus tard, ce rêve s’est fissuré. Nous ne sommes pas revenus entièrement au modèle d’avant, sans pour autant avoir construit un nouveau présent. Nous stagnons dans un entre-deux. Et beaucoup, tout simplement, se sont lassés d’attendre.
C’est dans ce contexte qu’émerge le concept de Grand Détachement, un phénomène désormais largement documenté dans les articles et rapports internationaux, succédant à la Grande Démission, au Grand Regret et au quiet quitting.
Le Grand Détachement en est une forme évoluée. Il ne s’agit plus seulement de quitter son emploi, mais d’un mal-être plus profond : celui de ceux qui se sentent émotionnellement déconnectés de leur entreprise, sans avoir la force ni les moyens de changer. Une désillusion silencieuse et insidieuse, faite d’apathie, de fatigue émotionnelle et de perte de sens.
Selon Gallup, l’institut de recherche qui a identifié et nommé ce phénomène, nous faisons face à un paradoxe. D’un côté, le turnover a ralenti par rapport aux années post-Covid les plus turbulentes. De l’autre, les collaborateurs sont moins engagés, moins satisfaits et plus enclins à chercher de nouvelles opportunités. Mais changer d’emploi est devenu plus risqué : inflation, instabilité économique, difficulté à trouver des entreprises réellement différentes… autant de freins au saut. Et ainsi, on reste. Mais à mi-chemin.
Les signes du Grand Détachement
Les chiffres sont parlants. Seuls 10 % des travailleurs italiens se sentent bien dans leur environnement organisationnel, selon l’Observatoire des pratiques d’innovation RH du Politecnico di Milano. 17 % se disent pleinement engagés. 14 % se définissent comme des démissionnaires silencieux : présents, mais prêts à faire le strict minimum. Et la proportion de ceux qui, bien qu’insatisfaits, ne cherchent même plus activement un nouvel emploi, est en hausse.
Autant de signes de désillusion et de déconnexion, aux causes multiples. Certaines sont systémiques. Depuis 2020, la plupart des entreprises ont connu des transformations organisationnelles rapides : fusions, restructurations, réductions budgétaires, nouvelles technologies, nouveaux outils, nouveaux rôles.
Souvent, ces changements se sont opérés sans stratégie claire ni récit partagé. Les équipes se sont fragilisées, les managers surchargés, les collaborateurs isolés. Le sens s’est perdu, ce sens qui, comme l’écrit Nicola Favini, directeur général de Logotel dans le dernier numéro de Weconomy, « n’est pas seulement le pourquoi qui différencie, mais l’âme qui meut et active » les entreprises et les organisations.
D’autres causes sont liées au travail hybride et à distance, largement répandu mais encore mal compris. Une enquête récente publiée dans la Harvard Business Review montre que les méthodes de gestion traditionnelles, conçues pour un monde en présentiel, ne fonctionnent plus. Les attentes sont floues, la collaboration entre équipes est entravée, les relations se distendent, le feedback se perd. Le travail devient une suite de tâches à accomplir, déconnectées d’un objectif plus large.
Ce n’est pas un hasard si les deux leviers fondamentaux de l’engagement au travail – la clarté des attentes et le lien avec la mission de l’entreprise – sont en forte baisse. Seuls 45 % des travailleurs savent ce qu’on attend réellement d’eux. Et seulement 30 % estiment contribuer à quelque chose qui a du sens. C’est dans ce vide que naît la grande désillusion.
Les nouveaux désabusés : non seulement le burn-out, mais le manque de sens
Le Grand Détachement ne se résume pas à la fatigue ou au manque de motivation. C’est une forme plus subtile d’aliénation. C’est se sentir inutile, même en étant productif. Ne plus se reconnaître dans les valeurs de l’organisation, dans ses décisions, dans ses priorités stratégiques.
Les plus touchés sont les jeunes générations, comme les travailleurs de la génération Z, et les profils à faible interaction sociale, notamment ceux en télétravail complet. Mais le phénomène est en réalité transversal. Il concerne les collaborateurs d’entreprises en mutation rapide, sans communication claire. Les nouvelles recrues, livrées à elles-mêmes. Les cadres intermédiaires, pris en étau entre des exigences irréalistes et des ressources limitées.
C’est une crise de sens, avant même d’être une crise organisationnelle.
L’époque de l’IA et de la solitude
Paradoxalement, l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le monde du travail – censée libérer du temps et valoriser le travail humain – risque d’accentuer ce détachement. D’après l’Observatoire du Politecnico, un salarié sur trois utilise des outils d’IA, gagnant en moyenne 30 minutes par jour. Mais ce temps est souvent réinvesti dans une productivité accrue, plutôt que dans des relations de qualité, du sens ou de l’apprentissage.
Le problème n’est pas l’IA en soi, mais son adoption désorganisée, sans vision stratégique, souvent via des outils personnels non fournis par l’entreprise. L’IA peut améliorer la qualité du travail, mais elle ne peut remplacer ce qui unit une communauté : la confiance, l’objectif partagé, le sentiment d’appartenance.
Comment réagir à ce postulat ?
Dans un contexte aussi complexe, la réponse des entreprises ne peut se limiter à faire revenir les collaborateurs au bureau ou à introduire de nouveaux outils. Un changement de perspective est nécessaire. Selon Gallup, deux priorités s’imposent : rétablir la clarté des attentes et renforcer le lien avec la mission de l’entreprise. Il ne s’agit pas de révolutions, mais de revenir à l’essentiel.
La clarté, c’est définir avec les collaborateurs ce qui est attendu, dans quel ordre de priorité, avec quels outils, et avec quel impact sur la charge de travail. C’est rendre visibles les critères d’évaluation, mais aussi les espaces de croissance et d’expérimentation. Et cela doit se faire dans un dialogue continu, pas lors d’un unique entretien annuel.
Le lien avec la mission, c’est rendre explicite le « pourquoi » de ce que l’on fait. Associer les résultats aux valeurs. Reconnaître la contribution de chacun. Célébrer les réussites collectivement. Aider chacun à percevoir son travail comme générateur de valeur.
Les entreprises qui réussissent – souvent celles qui adoptent des modèles organisationnels plus horizontaux et centrés sur les compétences – montrent déjà des signes encourageants. Dans ces organisations dites « basées sur les compétences », l’engagement passe de 17 % à 42 %, le bien-être de 10 % à 18 %, et la propension à quitter l’entreprise diminue.
Au-delà de la rhétorique de l’objectif
Mais une simple déclaration d’intention ou une campagne de marque employeur ne suffit pas. L’authenticité est essentielle. Il faut un leadership capable d’écoute et de reconnaissance de la complexité du moment. Il faut des espaces de dialogue, de confrontation intergénérationnelle, de reconnaissance mutuelle.
L’avenir du travail ne se joue pas uniquement sur le terrain de la technologie ou de la productivité. Il repose sur la qualité des relations, l’inclusivité des processus décisionnels, la capacité à créer des environnements de travail non seulement efficaces, mais aussi porteurs de sens. Car le véritable risque n’est pas seulement de perdre des talents, mais de les laisser sombrer dans la désillusion.