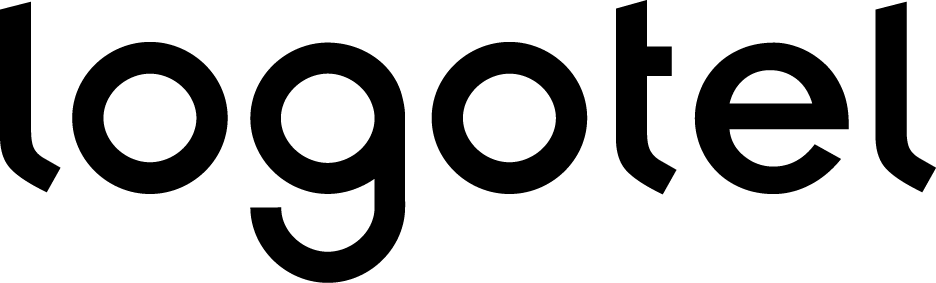Ces dernières années, le travail hybride s’est imposé comme l’un des principaux modèles organisationnels de l’après-pandémie. D’abord porté par l’urgence sanitaire puis consolidé par certaines études et les attentes des travailleurs, le travail qui alterne présence physique et activités à distance est devenu la « nouvelle normalité » pour de nombreuses entreprises et collaborateurs.
Mais cinq ans plus tard, avec des données plus solides disponibles et plus d’expérience sur le terrain, il est légitime de se demander : le travail hybride fonctionne-t-il vraiment ? Ou s’agit-il d’une solution temporaire, pleine de compromis ?
Un article récent de la Harvard Business Review a relancé le débat entre partisans et détracteurs de cette façon de travailler, en soulignant comment le travail hybride affaiblit la collaboration et la culture au sein des entreprises et des organisations, réduisant ainsi leurs performances. Dans cet article, nous essayons de faire le point sur la question.
L’essor du travail hybride : contexte et attentes
Après la phase d’urgence du Covid-19, de nombreuses entreprises ont décidé de conserver une certaine flexibilité dans leurs méthodes de travail. Selon une récente enquête menée par le MIT Sloan Management Review, la plupart des travailleurs aux États-Unis et au Royaume-Uni travaillent désormais à distance environ 30 % du temps, mais aimeraient aller jusqu’à 40 %. La génération Z, en particulier, est la plus flexible et est aussi la plus disposée à changer d’emploi si ses préférences ne sont pas satisfaites.
Cette demande croissante d’autonomie s’est combinée à la possibilité pour les entreprises de réduire les coûts liés à l’espace physique et, dans certains cas, d’élargir le bassin de talents potentiels. Le travail hybride s’est ainsi imposé comme la synthèse parfaite entre les besoins organisationnels et les attentes individuelles : plus de liberté pour les employés, économies pour les entreprises, continuité de la production pour les deux parties.
Et la fortune du travail hybride a également été alimentée par des études, comme celle intitulée Hybrid working from home improve retention without damage performance, publiée dans Nature.
Dans cette recherche, Nicholas Bloom, professeur d’économie à l’Université de Stanford, a souligné comment le travail hybride au sein d’une entreprise améliorait la satisfaction au travail et la rétention des employés, sans avoir d’effets négatifs sur les performances.
Les limites qui émergent : collaboration, performance, culture
Cependant, certaines analyses récentes, y compris celles citées dans l’article Hybrid Still Isn’t Working publié dans la Harvard Business Review, ont commencé à remettre en question certaines de ces croyances. Les données montrent que le travail hybride et à distance, s’il n’est pas conçu et géré avec des règles appropriées, peut compromettre la collaboration, affaiblir la culture organisationnelle et même réduire les performances de l’équipe.
L’un des problèmes les plus importants concerne l’intégration des nouvelles recrues. Sans la possibilité d’observer directement les collègues ou de poser des questions à la volée, l’apprentissage devient plus lent et plus fragmenté. L’absence de contexte et de relations informelles fait en sorte qu’il est plus difficile pour les nouveaux arrivants de se sentir membres du groupe et d’acquérir les compétences implicites qui ne sont transmises que par l’expérience partagée.
La collaboration horizontale en souffre également. Dans les environnements à distance, les travailleurs ont tendance à se concentrer davantage sur leurs objectifs individuels, souvent au détriment de l’entraide. Les demandes d’assistance par chat sont traitées plus lentement, et seuls ceux qui ont déjà une relation personnelle ont tendance à recevoir des réponses plus rapides.
Les réunions en ligne multiplient donc les participants mais réduisent l’efficacité. Dans de nombreux cas, ils se transforment en rendez-vous dispersifs, où une partie du groupe est distraite ou engagée dans plusieurs tâches à la fois. Cela conduit souvent à la nécessité de « réunions post-réunion » pour réaligner ceux qui n’ont pas suivi, avec une perte évidente de temps et de ressources et une augmentation de la gueule de bois des réunions, le sentiment de confusion et de frustration que l’on ressent à la fin des réunions infructueuses.
Les effets du travail hybride sur la formation
Un autre aspect critique lié au travail hybride concerne ses effets sur la formation. C’est un thème sur lequel la société de design indépendante Logotel, qui développe des projets de changement et d’apprentissage pour des clients de différents secteurs et tailles, étudie et expérimente depuis un certain temps.
L’expérience et les recherches de la société de design ont montré que le travail hybride et la numérisation ont transformé la façon dont les contenus de formation sont utilisés, qui sont devenus de plus en plus standardisés pour atteindre une population d’entreprises répartie dans des écosystèmes de plus en plus distribués.
D’une part, cela a augmenté les niveaux d’accessibilité, mais d’autre part, cela a réduit les niveaux d’implication des personnes, ce qui a eu un impact sur l’attention et la rétention des informations apprises et a obligé les entreprises et les organisations à recalibrer les expériences d’apprentissage, en adoptant de nouvelles perspectives et stratégies pour les rendre plus efficaces et percutantes dans la nouvelle logique hybride.
Le paradoxe hybride : plus de liberté, moins de connexions
Le travail hybride, tel qu’il est mis en œuvre dans de nombreuses organisations, connaît un paradoxe structurel. Elle garantit une plus grande liberté individuelle, mais érode en même temps les liens sociaux et culturels qui lient l’expérience de travail. Moins de temps partagé physiquement se traduit par moins d’occasions de nouer des liens, moins de culture transmise par la proximité, moins de confiance spontanée.
Selon l’article de HBR sur l’hybride qui ne fonctionne toujours pas, de nombreuses entreprises connaissent une double culture interne : d’une part, celles qui ont été embauchées avant la pandémie et qui ont vécu la culture « en direct » ; de l’autre, les nouveaux entrants, qui ne reçoivent qu’une interprétation partielle et médiatisée. Cela crée des frictions, des malentendus et des comportements divergents, qui peuvent saper la cohésion organisationnelle à long terme.
Que veulent vraiment les travailleurs ?
L’enquête MIT Sloan susmentionnée montre que la plupart des employés n’aspirent pas à un emploi complètement à distance, mais veulent un équilibre raisonné. Environ 75 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne travaillaient pas avec le rapport idéal entre présence et distanciel. Et plus intéressant encore, près d’un quart serait prêt à renoncer à une partie importante de son salaire pour obtenir plus de flexibilité.
En particulier, les travailleurs de la génération Z se disent prêts à sacrifier jusqu’à 30 % de leurs revenus afin d’avoir un modèle de travail cohérent avec leurs préférences. Cela suggère que la flexibilité n’est pas vécue comme un simple « avantage accessoire », mais comme un élément central du bien-être professionnel.
De la politique à la conception : comment rendre le modèle durable
Pour que le travail hybride devienne véritablement durable à long terme, il est nécessaire de passer d’une logique d’urgence ou permissive à une logique de conception. Il ne suffit pas de « quitter la liberté » : nous avons besoin de structure, de clarté, de cohérence. Les entreprises qui obtiennent des résultats positifs sont celles qui allient autonomie et discipline.
Parmi les interventions possibles, citons l’adoption de règles claires pour les réunions (par exemple, les caméras toujours allumées et la participation uniquement si pertinente), l’introduction d’indicateurs clés de performance relationnels (qui mesurent également le soutien aux collègues, le mentorat, la collaboration) et la formation des managers pour gérer des équipes distribuées de manière efficace et proactive.
L’onboarding des nouveaux collaborateurs est également à repenser : moments de présence obligatoire, jumelage avec des mentors experts, présentation directe aux collègues clés. Le tout soutenu par une transparence radicale sur les processus, les responsabilités et les objectifs, afin de réduire l’ambiguïté que le travail distribué implique souvent.
Leadership et cohésion dans les environnements distribués
Le succès du travail hybride dépend non seulement des politiques de l’entreprise, mais aussi d’une nouvelle approche du leadership. Les managers doivent apprendre à « voir de loin », à capter les signaux faibles, à donner du feedback en temps réel, à établir des liens intentionnels. Il ne suffit pas de superviser les travaux : il faut orchestrer la confiance, la collaboration et le sentiment d’appartenance.
Cela signifie, entre autres, favoriser les opportunités de socialisation réelle, même si ce n’est que périodique : journées bien organisées au bureau, activités transverses, bénévolat d’entreprise. Parce que les relations qui régissent le travail, aujourd’hui encore, se construisent dans le temps partagé et les gestes informels.
Le travail hybride peut donc fonctionner, mais il ne peut plus être laissé au hasard. Il est temps de le traiter comme un véritable modèle d’organisation, à concevoir, à réguler et à former. Les entreprises qui y parviennent amélioreront non seulement leur productivité, mais créeront également des lieux de travail plus humains, durables et attrayants.