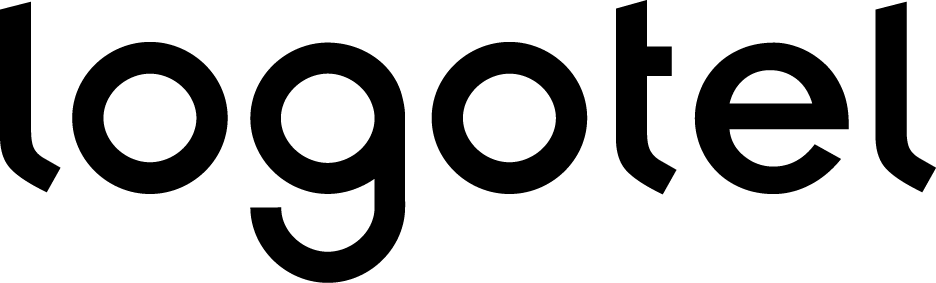La semaine de quatre jours affiche des gains en productivité et en bien-être, mais ce modèle n’est pas universel. Voici les points clés avant de l’adopter.
Ces dernières années, le monde du travail a connu de profondes transformations.
Si certaines évolutions étaient déjà amorcées, la véritable accélération est venue avec la pandémie. Les mesures d’urgence liées à la Covid-19 ont poussé entreprises et administrations à expérimenter de nouvelles formes de flexibilité : télétravail, travail hybride, et même des modèles plus radicaux comme la semaine de quatre jours.
Ce dernier n’est plus une utopie réservée aux visionnaires, mais une réalité qui s’inscrit dans la tendance des nouveaux modes de travail. Des milliers de personnes dans plusieurs pays, dont l’Italie, participent à des expérimentations qui alimentent un débat mondial.
Mais cette solution est-elle réellement efficace ? Décryptage dans cet article.
Une idée ancienne redevenue actuelle
La réduction des jours de travail n’est pas nouvelle. En Italie, la semaine de 40 heures – norme dans la plupart des secteurs – a été fixée par la loi en 1997, après des conquêtes sociales dans les années 1960-1970. À cette époque, les premières propositions de réduction du temps de travail apparaissaient, portées par la hausse de la productivité industrielle.
Le paradigme était alors différent : plus de technologie signifiait plus de production, donc plus de travail. Aujourd’hui, la logique s’inverse : avec l’automatisation et l’IA promettant davantage de productivité en moins de temps, le défi est d’assurer bien-être, engagement – très faible en Italie et ailleurs – et durabilité du travail.
La semaine courte revient ainsi au centre du débat, non comme une concession, mais comme un levier stratégique pour lutter contre le burn-out, le désengagement et des phénomènes comme le « le grand détachement », ce sentiment croissant de distance émotionnelle vis-à-vis du travail.
Les preuves des expérimentations à grande échelle
Le tournant s’est produit avec des tests massifs. L’un des plus marquants : le Royaume-Uni en 2022. Plus de 60 entreprises et 3 000 salariés ont expérimenté pendant six mois le modèle 100-80-100 (100 % du salaire, 80 % du temps, 100 % de productivité).
Résultat : nette amélioration du bien-être, baisse du stress, hausse de la satisfaction personnelle et familiale. De nombreuses entreprises ont poursuivi le modèle après l’expérimentation.
Plus récemment, Juliet B. Schor, économiste et sociologue au Boston College, a publié Four Days a Week (Harper Business), synthèse de la plus vaste étude sur la semaine de quatre jours : 245 organisations et 8 700 employés dans divers secteurs et pays.
Dans une interview publiée dans le MIT Sloan Management Review, elle souligne des résultats « étonnamment positifs » :
- 20 indicateurs de bien-être en hausse
- intensité du travail stable
- liens sociaux préservés
- productivité maintenue ou améliorée
Fait notable : après un an, 90 % des entreprises ont conservé le modèle, preuve de sa viabilité.
Ces données battent en brèche un préjugé tenace : moins de jours ne signifie pas moins de production.
Pourquoi ça marche : la productivité en question
Peut-on faire plus en travaillant moins ? Les preuves semblent l’indiquer.
La réduction des jours impose une rationalisation des activités :
- moins de réunions inutiles
- plus de concentration
- priorité aux tâches à forte valeur ajoutée
En clair, la semaine courte pousse à distinguer l’essentiel du superflu, réduit le temps perdu dans les tâches répétitives et allège la charge mentale.
Le bien-être comme facteur de compétitivité
La semaine de quatre jours ne se limite pas à l’efficacité : elle améliore la qualité de vie.
Les salariés dorment mieux, passent plus de temps en famille, cultivent leurs passions. Or bien-être et performance sont liés :
- moins de burn-out = moins d’absences
- moins de turnover = plus d’engagement
Dans un marché tendu, proposer un modèle durable devient un atout pour attirer et fidéliser les talents. Pas étonnant que la satisfaction des employés atteigne des niveaux records dans les entreprises qui l’ont adopté.
Les limites et les défis à relever
Tout n’est pas simple. La semaine de quatre jours pose des défis organisationnels :
- certains secteurs (santé, commerce, logistique) exigent une présence continue,
- risque d’inégalités : métiers créatifs ou digitaux mieux adaptés que les tâches manuelles ou de service,
- danger d’intensification du rythme pour compenser la réduction du temps.
Ce dernier point ne s’est pas vérifié dans l’étude du Boston College, mais il reste à surveiller.
Enfin, comme pour le travail hybride, la semaine courte n’est pas une formule magique. Son succès dépend du contexte, des objectifs et des besoins spécifiques de chaque organisation.
Un nouveau contrat psychologique
Ce qui rend la semaine courte particulièrement intéressante, ce n’est pas seulement la réduction des heures de travail, mais le nouveau pacte implicite qu’elle propose entre l’entreprise et ses collaborateurs : travailler moins pour travailler mieux.
L’accent ne porte plus sur le temps passé au bureau, mais sur les résultats obtenus. Un changement qui devrait également être au cœur du véritable « travail intelligent », souvent réduit à du télétravail sans réelle refonte des pratiques.
Ce paradigme exige confiance, clarté des objectifs et une nouvelle manière d’évaluer la performance. La semaine de quatre jours devient ainsi une expérience culturelle, qui remet en question les modèles hiérarchiques et les métriques traditionnelles. Elle pousse à repenser les processus, à renforcer l’autonomie des équipes et la responsabilité individuelle.
Insérée dans un contexte plus large, la semaine courte s’articule avec d’autres transformations : travail hybride, adoption massive de la GenAI, importance croissante du bien-être psychologique et attentes des nouvelles générations.
Comme toute transformation, elle doit être accompagnée. Chez Logotel, nous insistons sur ce point : depuis 1993, nous aidons les entreprises à donner du sens aux changements et à l’innovation. Une fois la direction fixée, il est essentiel que toutes les parties prenantes s’engagent et adaptent leurs comportements pour rendre la transformation agréable, productive et durable.
Conclusion : est-ce que ça marche vraiment ?
À la question initiale – la semaine de quatre jours fonctionne-t-elle ? – la réponse est : oui, dans de nombreux cas, mais pas pour tout le monde et pas sans repenser les modèles organisationnels. Ce n’est pas une solution universelle : elle doit résulter de choix stratégiques clairs et s’accompagner de trajectoires de transformation partagées et durables.
Ce modèle peut réussir si les entreprises redéfinissent leurs processus et leurs indicateurs, s’appuient sur la confiance et la culture, et placent réellement le bien-être des collaborateurs au centre. Il peut fonctionner s’il répond à un besoin profond d’équilibre et de sens, porté avec force par les nouvelles générations.
En Italie, des entreprises comme Intesa Sanpaolo, Lamborghini, Luxottica, ainsi que certaines administrations publiques, ont déjà commencé à expérimenter cette approche. Comme toute nouveauté, il faudra du temps pour en tirer des conclusions solides et savoir si elle peut devenir la nouvelle norme du travail.